| HISTOIRE DE WOIPPY - WOIPPY PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE |
|---|
Woippy dans la Seconde Guerre mondiale
1939 - 1945
1- Texte d'une conférence présentée par Pierre BRASME, président de la SHW, lors du Colloque organisé par l’Association des Amis du Mémorial de l’Alsace et de la Moselle à Colmar (15-17 octobre 2002) sur le thème : Août 1942 : l’incorporation de force des Alsaciens et des Mosellans dans les armées allemandes
Située à quelques kilomètres au nord-ouest de Metz, au pied des côtes boisées et aux
portes de la vallée industrielle de la Moselle, Woippy est à des années-lumière
d’être en 1939 la cité qu’elle est aujourd’hui, c’est-à-dire une petite ville
de quelque 14 000 habitants, aux activités essentiellement industrielles
et tertiaires, fruit d’une mutation exemplaire qui s’est brusquement révélée à
partir des années 1960.
Le Woippy de 1939, c’est d’abord une
population qui vient tout juste de franchir le seuil des 2000 habitants : ils
étaient 1859 au recensement de 1936, et sont 2128 si l’on s’appuie sur le
nombre de masques à gaz à distribuer au cas où, établi par un état daté du
9 février 1939. Une population concentrée autour d’un vieux noyau villageois
hérité du Moyen Age, et qui vit majoritairement du travail de la terre. A
Woippy, le travail de la terre, c’est avant tout la culture de la fraise, qui,
introduite à la fin du Second Empire, deux ans avant le drame de 1870, s’est
développée sous la première annexion avant d’essaimer dans le Val de Moselle. Culture
de haute réputation, dont la production, pour l’ensemble des communes
fraisières, atteint son apogée durant les dernières années de
l’avant-guerre : 5 à 6000 tonnes par an, sur des fraiseraies totalisant
1200 hectares. La commercialisation en est assurée par un Syndicat des
Producteurs de Fraises à la tête duquel œuvre le marquis Henry de Ladonchamps. Quelques entreprises industrielles,
métallurgiques surtout, se sont implantées depuis les années
1920, employant quelque 300 ouvriers.
La guerre va bouleverser tout cela. Avec les expulsions de 1940, les déportations
et les réquisitions, puis l’évacuation de 1944, elle va disperser la
population. Elle va porter à la fraisiculture un coup
qui eût été mortel sans l’opiniâtreté des producteurs dès leur retour en 1945.
Elle va faire de Woippy une localité meurtrie tant par les exactions de
l’occupant que par les destructions qui accompagneront sa libération. Les cinq
années de guerre, d’occupation, de germanisation et de nazification sont pour Woippy
et les Woippyciens, comme partout en Moselle, des
années d’épreuves, de souffrance matérielle et morale, de peur, de contraintes,
mais aussi de courage pour celles et ceux qui entreront en résistance ou
connaîtront le sort des Malgré-Nous ou l’enfer de la
déportation.
Dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en Moselle, il n’est pas inintéressant de saisir le
destin d’une commune qui a souffert à la fois des expulsions, de
l’incorporation dans le R.A.D. et dans la Wehrmacht
et d’une évacuation précipitée en 1944, qui a abrité une usine travaillant pour
la Luftwaffe et un camp de détention qui sera, à l’instar de celui de Queuleu, reconnu comme lieu de déportation, et où les
actions de résistance n’ont pas été des moindres. Une commune qui, le 12 juin
1949, se verra remettre la Croix de Guerre avec étoile d’argent et cette
citation : « Village de Lorraine durement éprouvé par les
bombardement et les combats qui ont été livrés sur son territoire et qui lui
valurent 8 tués, 3 blessés et la destruction de 40% de ses habitations. Woippy,
malgré les souffrances de sa population, a conservé un moral admirable et
déployé une action résistante dont témoigne le nombre de ses familles déportées
et expulsées ».
Evoquons d’abord le problème des expulsions, qui a laissé dans la mémoire de nombreux
Woippyciens un souvenir amer. Certains, que je côtoie
encore à Woippy, m’en ont livré le témoignage. Comme cette femme, qui alors
était encore écolière : « Nous étions en classe lorsqu’on vint
nous dire de rentrer tout de suite chez nous. Notre mère avait préparé les
valises et nos sacs à dos. Elle nous glissa encore un oreiller entre le dos et
le sac, puis nous mit des couvertures sous le bras. Nous prîmes le car et
on nous débarqua au pied du château d’eau de la gare de Metz. Des wagons dont
le siège était en bois nous attendaient en haut de la
rampe. Puis beaucoup plus tard, le train partit, les wagons étaient surveillés
par des soldats. Arrivés à Mâcon, les Allemands descendirent et des Sœurs de la
Croix Rouge s’occupèrent de nous ». Après avoir traversé la vallée du
Rhône et la plaine languedocienne, le convoi arrive à Agen, et notre témoin de
poursuivre : « Nous sommes montés dans un autocar et nous avons
voyagé encore longtemps, et enfin nous étions arrivés. Il faisait froid. Nous
étions dans des grandes baraques en bois, contenant une cinquantaine de lits.
Il y avait un robinet dehors, mais l’eau était gelée. Nous étions à côté
d’Auch, dans un ancien camp de réfugiés espagnols ». Roger Tailleur,
alors âgé de 18 ans, m’a également livré ses souvenirs : « On se
doutait que quelque chose se préparait… Nous avons eu la visite d’un gradé
allemand, qui a demandé à mon père la composition du logement, le nombre de
pièces, s’est fait remettre notre livret de caisse d’épargne, et nous a fait
sortir du logement avant de mettre les scellés sur les portes. Nous sommes
descendus sur le trottoir avec nos baluchons ; on était habillés avec le
plus de vêtements possible : j’avais deux pantalons, deux chemises, trois
gilets, une veste et un manteau ». Avec d’autres expulsés, la famille
Tailleur débarque à Senouillac le 18 novembre, et se
voit affecter une maison désaffectée : « Les femmes marchaient en
pleurant, c’était pire qu’un enterrement. Quand ma mère a vu la chaumière, elle
a fondu en larmes. On nous a finalement logés dans le pigeonnier d’une maison
de maître, où nous avons vécu quelques mois à trois familles, soit neuf
personnes ».
Entre le 16 et le 22 novembre 1940, 455 Woippyciens ont été
expulsés, dont 410 dans la seule journée du 17. Si l’on y ajoute ceux qui l’ont
été en août-septembre (parmi eux le curé de Woippy et
les religieuses enseignantes), et la vingtaine qui le seront en avril 1941, ils
sont près de 500, soit le quart de la population woippycienne
d’alors. 70% des expulsés sont réinstallés dans une dizaine de communes
d’accueil du Tarn et de Haute-Garonne, notamment à Gaillac, Lavaur et Mazamet,
et 20% dans la commune de Saint-André-de-Cruzières,
en Ardèche.
Les débuts sont difficiles pour cette population
qu’on regarde d’un mauvais œil et qui se sent perdue et déracinée, comme
l’indique le témoignage de Roger Tailleur : « La première année a
été terrible. On n’avait bien entendu pas de mobilier ; le Secours
national nous a donné une table, une chaise par personne, un petit fourneau de
fonte, 50 kg de charbon et des lits en bois à étage avec une couverture chacun.
On a passé dans ces conditions un hiver très rude, avec des congères d’un
mètre ! Rien à manger : on ne connaissait personne, et on n’avait que
nos malheureux tickets ; alors on braconnait un peu ; comme on
n’avait pas de charbon, on allait déterrer des piquets de vigne ».
Mais, peu à peu, les choses s’améliorent, la débrouillardise aidant ; on
se met à cultiver pommes de terre et topinambours. Le réseau des connaissances
s’élargit. Certains expulsés épousent des hommes ou des femmes du pays, comme
justement Roger Tailleur, qui vit encore à Woippy avec son épouse, originaire
de Gaillac. La confiance renaît, et avec elle l’espoir de rentrer un jour au
pays : « La première chose qu’on faite mes parents en arrivant à
Gaillac, poursuit Roger Tailleur, c’est d’acheter deux grandes malles en
vue du retour. On n’a jamais pensé qu’on resterait là-bas ».
Qu’advient-il des Woippyciens restés au pays ? Comme les
Mosellans qui n’ont pas été expulsés, ils deviennent des Volksdeutsche,
qui sont instamment priés d’adhérer à la Deutschvolksgemeinschaft,
la Communauté du Peuple Allemand. Ont-ils été nombreux à le faire ? Nous
avons recensé quelque 200 fiches nominatives aux Archives départementales de la
Moselle, deux cents personnes à signer la profession de foi au Führer et au
peuple allemand, soit 1 Woippycien sur dix, ce qui
prouve que la grande majorité des habitants est hostile à l’ordre nouveau
imposé par l’occupant…
S’ils peuvent refuser l’adhésion morale à l’Allemagne nazie, les jeunes Woippyciens
ne peuvent échapper à l’embrigadement imposé en
1941 par les nazis. Le 23 avril, le Gauleiter Joseph Bürckel
annonce que les jeunes gens des deux sexes, âgés de 17 à 25 ans révolus, sont
susceptibles d’être appelés au R.A.D. pour une
préparation militaire de six mois. Parmi les jeunes Woippyciens
incorporés au R.A.D., René Thiriet
raconte : « Etant de la classe 25, la durée de mon incorporation
de force au R.A.D. était limitée à une période de
trois mois au lieu de six au départ, ceci afin d’activer l’incorporation dans
l’armée. Ces trois mois ont été pour moi les moments les plus difficiles de ma
jeunesse ». Si René Thiriet et son frère
Gaston échappent à cette incorporation en s’évadant (ce qui vaudra à leur père
d’être interné), il n’en est pas de même de 35 jeunes hommes du village qui se
retrouvent sous l’uniforme allemand, dont 6 seront tués ou portés disparus sur
le front de l’Est. L’un de ces Malgré-Nous relate les
derniers mois de sa guerre : « Avec quelques Lorrains, nous nous sommes
enfuis en direction de l’ouest. Nous nous déplacions
la nuit et nous cachions le jour. Nous avons voyagé par avion plusieurs heures
de nuit dans un train d’atterrissage, nous avons failli mourir de froid. En
dernier, il a fallu passer un fleuve sur un petit pont gardé par un vieil
Allemand armé d’un fusil. Il n’a pas voulu comprendre que c’était fini pour
l’Allemagne, nous avons réussi à la maîtriser et nous l’avons noyé dans la
rivière pour qu’il ne nous dénonce pas. C’est la seule personne que nous avons
tuée pendant toute la guerre ».
La dispersion de la population woippycienne se poursuit
avec l’évacuation forcée de septembre 1944, qui annonce les combats de la
libération. J’ai pu recueillir à ce sujet
plusieurs témoignages. Ainsi celui d’un agriculteur, Clément Mayot : « J’étais en train de traire les
vaches avec ma mère, et mon père s’occupait des chevaux à l’écurie. Des
Allemands sont venus nous dire de quitter la maison : Raus,
raus, sortez de la maison ! Je vois encore tous
les gens du quartier, qui étaient comme nous, dehors. J’ai pris ma bicyclette.
Les Allemands nous ont rassemblés près du Café de la Gare ; on était une
centaine. Un policier m’a dit : On vous emmène en Allemagne. Un soldat m’a
arraché mon vélo des mains. Finalement, on est arrivés à Pange
à six heures du soir, et nous y sommes restés jusqu’au mois de décembre. Quand
on est rentrés, il n’y avait plus rien ». Certains habitants ont pris
les devants et se sont réfugiés dans les bois, d’autres se barricadent en
attendant l’arrivée des Américains, mais sont finalement chassés. Et, lorsque
les premiers éléments du 377e régiment d’infanterie américain entrent
dans Woippy, le 16 novembre 1944, il n’y a plus âme qui vive, à l’exception des
hommes embusqués du 1215e régiment d’infanterie de la Wehrmacht.
Avant d’évoquer cette libération, il me semble important de montrer le rôle joué dans
la Résistance par un certain nombre d’hommes et de femmes. Parmi celles-ci, je
voudrais citer Catherine Welfringer, qui résidait à
Woippy depuis 1926. Dès 1940, elle adhère avec sa fille Blanche à un réseau de
résistance spécialisé dans l’évasion de jeunes Lorrains réfractaires, de
prisonniers français évadés et de Juifs. Dénoncée, elle est arrêtée en août
1943 et internée à la prison de femmes de Metz, avant d’être envoyée avec
Blanche au camp de Ravensbrück, dont elles reviendront. Je citerai aussi Edmond
Crousse, membre du groupe Mario, arrêté par la
Gestapo le 12 septembre 1942 et envoyé à Dachau, où il meurt en décembre 1944.
André Tiné, entré dans la Résistance à l’âge de 15
ans, arrêté avec sa famille et déporté au camp de Panewnick en
Haute-Silésie puis dans celui de Ratibor,
qui dépend d’Auschwitz ; condamné à mort par un tribunal militaire pour avoir
refusé d’être incorporé dans la Wehrmacht, victime d’une parodie d’exécution,
incarcéré à la forteresse de Glatz, il est finalement
libéré par l’Armée Rouge, et rapatrié en France le 28 mai 1945. Ou encore Henri
Mangenot, qui appartient aux Francs-Tireurs et Partisans, qui est dénoncé sous
la torture par un camarade et qui est arrêté
le 23 mai 1944. Comment enfin ne pas citer, même si son histoire a été
controversée, Ernest Kempnich, dont
l’action résistante a été portée à l’écran en 1946 par René Clément, de manière
amplifiée et déformée, sous le titre Le Père Tranquille - c’était son
surnom - et interprétée par l’acteur Noël-Noël.
Horticulteur à Woippy, il devient en 1941 membre d’une filière d’évasion pour
prisonniers français, et en mai 1944 se voit confier par Alfred Krieger (alias
le commandant Gregor) un poste émetteur permettant les contacts avec Londres.
Nommé par les F.F.I. adjoint intérimaire au maire
provisoire Edmond Moppert, il est chargé de la
réorganisation des services municipaux. Le Père Tranquille mourra le 1er
janvier 1978, âgé de 90 ans.
Il aurait pu tout aussi bien trouver la mort le 27 mai 1944, lors du bombardement
par l’aviation alliée de l’usine Hobus Werke, située à proximité de son établissement horticole.
Cette usine, construite en 1941, est spécialisée dans la boulonnerie de
précision pour moteurs d’avion, et fabrique également des hélices et des
éléments de circuits hydrauliques. Il s’agit en fait d’un complexe assez
important, comprenant six halles de fabrication, dont deux affectés à la
société V.D.M. (Vereinigte Deutsche Metalwerke). La direction et les cadres
de l’entreprise sont évidemment allemands, et l’usine possède une école de formation
professionnelle, installée dans les locaux de l’actuel lycée Louis-Vincent de Metz.
La main-d’œuvre, féminine à 80%, est recrutée sur place, c’est-à-dire dans la
région messine, et complétée par des prisonniers russes, ukrainiens, polonais
et yougoslaves. L’usine est défendue par des canons de 20 mm installés sur des
miradors et servis par une unité de la Flak, puis par
des adolescents allemands, lorrains, alsaciens ou luxembourgeois, certains âgés
de seulement 15 ans. Une défense aérienne qui ne pourra éviter la destruction
de l’usine par les bombardements alliés des 27 mai et 18 août 1944, la deuxième
attaque visant aussi l’aérodrome de Metz-Frescaty.
Nul doute qu’en voyant les bombes détruire les installations allemandes, les
détenus du camp voisin (certains d’ailleurs y travaillaient) n’aient éprouvé à
la fois les pires craintes et l’espoir le plus grand, celui de voir se
rapprocher la fin de leur calvaire. C’est en septembre 1943 que Woippy (en fait
les terrains appartiennent à la ville de Metz) est doté d’un camp de
prisonniers, comprenant deux baraques d’une dizaine de chambres, chacune
pouvant abriter 7 à 800 détenus, essentiellement des prisonniers de guerre
russe. Le camp aurait accueilli au total 4336 détenus, dont 464 résistants, déserteurs
ou réfractaires mosellans. Parmi eux, 14 membres du Groupe Mario, et 123 habitants
de Longeville-lès-Saint-Avold, parents de réfractaires, dont une quarantaine mourront
en camp de concentration.
(voir les témoignages d'anciens déportés ci-dessous)
Le camp de Woippy, reconnu en 1947 comme lieu de déportation (au même titre que le
fort de Queuleu) est commandé par l’Obersturmführer SS Fritz Kirchdorfer,
personnage cynique et cruel prédestiné à ce type de besogne. Il est en
particulier responsable de la mort, suite à mauvais traitements, d’Henri Chavet,
président fondateur du groupement des Expulsés de
Moselle. Lors de son procès, à Metz en 1948, Kirchdorfer
reconnaîtra aussi avoir abattu deux prisonniers russes à la mitraillette. Sans
doute est-il aussi responsable du massacre d’environ 150 prisonniers
soviétiques, dont les ossements ont été découverts en avril 1963 à Metz-Nord, pendant les travaux de nivellement de
l’autoroute Metz-Thionville. Dans la nuit du 31 août
au 1er septembre 1944, les Allemands abandonnent le camp et ses
détenus, alors au nombre de 550. Et c’est un Woippycien,
Pierre Kopp, qui avertit ces derniers et leur ouvre
les portes de la liberté. Mais les Allemands reviennent deux jours plus
tard : le camp est naturellement vide, et la tête de Pierre Kopp est mise à prix. Il est arrêté à Metz le 29 octobre
sur dénonciation. La libération de Metz moins de deux mois plus tard lui
sauvera la vie.
Avant de libérer Metz, il faut libérer Woippy. C’est chose faite le 16 novembre 1944,
grâce à trois compagnies du 2e bataillon du 377e régiment
d’infanterie américain. Le village est vide, mais les Allemands sont bien
embusqués, et il faudra attendre 14 heures pour que le village soit libéré,
après quelques actions héroïques comme celle du sergent Andrew Miller, dont
voici le texte de la citation obtenue : « Le 16 novembre, à
Woippy, alors qu’il se trouvait à la tête d’une escouade de fantassins, le tir
croisé de mitrailleuses ennemies immobilisa son unité. Il ordonna à ses hommes
de se mettre à couvert et, seul, il s’avança, entra dans un bâtiment qui
abritait l’une des mitrailleuses, et à la pointe de sa baïonnette obligea cinq
Allemands à se rendre. Ensuite, sans l’aide de quiconque, il s’empara de la
seconde mitrailleuse au moyen de grenades lancées sur la position ennemie,
tuant deux soldats, en blessant trois autres et faisant deux prisonniers ».
Le sergent Miller trouvera la mort le 29 novembre suivant, il est inhumé au
cimetière américain de Saint-Avold.
Si le village est libéré, plus durs sont les combats pour la prise du fort Gambetta,
à quelques centaines de mètres de Woippy. Les Allemands, fortement retranchés,
opposent une farouche résistance, et le fort, abandonné, n’est pris que le 22,
le jour même de la reddition de Metz.
Woippy est libéré, mais Woippy est ruiné par les combats pour sa libération. Le bilan
est lourd, et la cicatrisation sera longue et difficile. Les expulsés rentrent
peu à peu, et il faut les reloger. Beaucoup ont tout perdu, et il faut les
aider. La culture de la fraise est sinistrée, et il faut tout reprendre à zéro
(de 320 hectares de fraiseraies en 1939, il n’y en a plus d’exploitables que 20
en 1943). Le village a été détruit ou endommagé en grande partie (on compte
environ 200 maisons sinistrées), et il faut reconstruire. Grâce à leur courage
et à leur opiniâtreté, les Woippyciens vont y
parvenir. Mais, ce qu’ils ne savent pas encore, c’est que l’après-guerre,
passées ces années douloureuses, va transformer leur vieux village en une ville
qui, encore aujourd’hui, est l’une des plus dynamiques et des plus vivantes de
l’agglomération messine. Mais une commune aussi qui sait se souvenir, et où les
associations patriotiques entretiennent, notamment auprès des jeunes, les
« chemins de la mémoire ».
2- Témoignages d'anciens déportés du camp de répression nazi de Woippy
Le récit de René RATOUIS
Réquisitionné par les Allemands dans le cadre du
Service du Travail Obligatoire (S.T.O.), René Ratouis, alors âgé de vingt ans, quitte Paris pour l’Allemagne
le 17 mars 1943, destination Hambourg. Il passe plusieurs mois dans le camp d’Altona, puis dans celui de Nordersand,
d’où il assiste au bombardement de Hambourg par l’aviation anglaise, qui en une
semaine fait 70 000 morts. Après quelques semaines passées à Brême, il
revient à Hambourg, comme ouvrier aux usines Blohm et
Voss, d’où il s’évade le 1er avril 1944, en compagnie d’un jeune
officier français, Marcel Denquin, évadé de son oflag,
mais tous deux sont arrêtés le lendemain en gare de Metz, avant d’être
interrogés à Novéant puis internés au camp de Woippy.
Il y reste durant six semaines. Ramené à Hambourg, il ne reviendra en France
que le 9 mai 1945.
Au cours de l’année 2003, René Ratouis a publié son
récit de guerre sous le titre « Mémoires de guerre d’un
non-combattant »[1],
dont est extrait le passage suivant.
Nous avons passé la porte d’un camp entouré d’une double rangée de barbelés
et gardé par des SS. C’était le camp de Wappingen, nom que les Allemands avaient
donné au village de Woippy. Les formalités furent rapides : nous avons
vidé nos poches et en avons laissé le contenu, ainsi que nos montres, à un
employé au visage émacié, vêtu d’un pauvre costume gris. Un autre nota mon nom,
mon employeur et mon adresse à Hambourg. C’était tout. Les SS se mirent à crier : - Schnell ! Schnell !
Sans autre explication que de rudes bourrades et quelques coups de crosses, ils nous
dirigèrent vers une baraque, et nous poussèrent dans une pièce meublée d’une
vingtaine de lits superposés deux à deux. Il n’y avait pas d’autre occupant
dans cette pièce […] On nous laissa mijoter dans la chambrée sans nous
distribuer quoi que ce soit. Je n’avais rien absorbé depuis que j’avais quitté
Nordersand la veille en fin d’après-midi. Marcel était dans
la même situation que moi à cet égard. Nous avions faim et surtout soif, une
grande soif.
Les lits n’avaient pas assez de planches pour être occupés tous ; les paillasses tenaient
sur les lits du haut par trois ou quatre planches alors qu’il en aurait fallu
une douzaine ; ces planches-là étaient d’ailleurs prélevées sur les lits
du bas. Pour dormir, nous avons posé au sol les paillasses des lits supérieurs
de façon à récupérer les traverses ainsi devenues disponibles pour compléter
les planches sur lesquelles reposaient les paillasses des lits inférieurs. Au
matin, nous avons remis en place les lits factices, par crainte de sanctions
Jusque-là, nous n’avions eu que peu de contacts avec nos geôliers. Cela changea après que
nous fussions réveillés. Un grand SS avec une sale gueule –
« figure » n’aurait pas été le mot approprié – fit irruption dans la
pièce et nous enjoignit d’aller aux toilettes. Les seuls mots qu’il prononça étaient : -Schnell ! Schnell !
Il aboyait, vociférait et distribuait des coups de poing et des coups de pied pour
nous faire accélérer le mouvement. Au bout de la baraque, il y avait une salle
d’eau, munie de robinets dont l’eau coulait dans des bacs, sorte de lavabos
collectifs ; cela aurait été satisfaisant si nous avions eu un peu de
savon et avions pu nous dévêtir. Mais on ne nous en laissa pas le temps ;
d’autres SS, de moins grande taille que le premier, étaient là qui tapaient et
aboyaient : - Schnell ! Schnell !
Nous avons pu tout juste nous passer les mains et le visage à l’eau avant d’être
reconduits à la chambrée avec les mêmes égards, où l’on nous enferma de
nouveau. Simultanément, nous avions entendu une cavalcade et d’autres
vociférations que nous avions interprétées comme la séance de toilette d’une
chambrée voisine ; il y eut encore trois autres séances identiques, ce qui
faisait donc cinq chambrées en tout dans cette baraque. Existait-il d’autres
chambrées inoccupées ce matin en attente de nouveaux arrivants ? Nous
n’avions pas eu la possibilité, à notre arrivée, de nous faire une idée de
l’importance de ce camp.
C’était une sorte d’entrée en matière. Le plus grand des SS portait des galons de
sous-officier. Les devait-il à sa haute taille ou à sa férocité ? De toute
façon, il n’avait pas obtenu son avancement pour son intelligence ou son
instruction. Nous avons eu un peu plus tard connaissance de son nom que nous
avons à peine déformé en « Savatski » pour
notre usage. Tout comme les SS non gradés, il faisait partie de minorités
allemandes installées en Russie depuis des générations ; ils parlaient
tous un allemand approximatif. Au-dessus d’eux, nous trouverons une sorte de feldwebel
(adjudant) ou d’un grade équivalent chez les SS, véritable Allemand mais pas
meilleur que ses subordonnés. Nous ne verrons que rarement des officiers SS au
camp ; cela valut peut-être mieux pour nous.
Après ce simulacre de toilette, les occupants de toutes les baraques furent rassemblés
dans une cour en terre battue. Cela se fit encore avec des cris, des coups et
des Schnell ! Schnell !
On nous mit en rangs. L’adjudant apparut et hurla quelque chose que
personne ne traduisit et dont nous n’entendions que quelques mots épars car il
était assez loin et il y avait du vent. Après ce discours, on nous distribua un
breuvage presque noir, au goût de saccharine, et qui était chaud ; nous
devions le boire sur place en restant en rangs. Je le trouvai réconfortant et
même bon ; c’était le premier liquide que j’absorbais depuis environ
quarante-huit heures, et si j’en avais eu la possibilité, j’en aurais
redemandé. Je pris ainsi un peu plus conscience de l’état où j’étais
réduit ; notre arrestation ne remontait pourtant qu’à vingt-quatre heures.
Nous avons réintégré les chambrées avec les politesses SS : cris,
coups et « Schnell ! ». J’essayais prudemment de me tenir au
milieu du groupe ; quant à lui, Marcel fermait volontairement la marche et
il recevait plus de coups que les autres. Quand je lui demandai pourquoi il
agissait ainsi, il me répondit que cela évitait des coups à certains, et il
ajouta, tel un scout ayant fait sa B.A. : - C’est chic, non ?
[…] Rien ne se passa après que nous fussions revenus dans la chambrée. Nous étions
étonnés de ne pas travailler et que les SS nous laissent tranquilles. La
journée se déroula dans la chambrée, porte et fenêtres fermées. Nous parlions
entre nous, c’était notre unique occupation, assis sur les châlits, plus
exactement sur les montants de bois des lits inférieurs parce qu’il aurait été
dangereux de démonter les lits factices du niveau supérieur ; certains
s’asseyaient directement sur le sol.
Un nouveau compagnon fut introduit avec la délicatesse coutumière de nos anges gardiens.
Le nouveau venu avait la nationalité américaine et devait avoir entre quarante
et cinquante ans. En fait, c’était un Allemand naturalisé américain ; en
novembre 1941, il était venu en Europe voir des parents et il n’avait pas eu
l’autorisation de quitter l’Allemagne pour retourner aux Etats-Unis quand la
guerre éclata entre ces deux nations. Depuis, on le traînait d’un camp dans un
autre, et sa stupéfaction restait ce qu’elle avait dû être au premier jour de
son arrestation :
- Je leur dirai, à mes compatriotes, quand je rentrerai aux Etats-Unis,
comment les Allemands se comportent. Il faut qu’ils sachent…
[…] Vers cinq heures de l’après-midi,nous acons été extirpés
des chambrées avec le cérémonial propre aux SS, et avons à nouveau été mis en
rangs, dans le silence, sans bouger, dans une position voisine du
« garde-à-vous ». Enfin, l’on nous distribuait quelque chose à
manger… C’était une ration quasi normale dans les camps de S.T.O.
que j’avais connus : soupe, pain, margarine et un indéfinissable pâté. La
différence avec les camps de liberté (§) résidait dans le fait que les SS
avaient simplifié les problèmes de distribution en n’y procédant que deux jours
sur deux. Il était possible qu’en théorie la ration de base ait été augmentée
en conséquence. Dans la pratique, il en allait bien autrement : le pain –
bien noir – avait peut-être un centimètre d’épaisseur en plus qu’à Hambourg
mais je n’en avais pas l’assurance ; il en allait de même des cubes de
margarine et de pâté ; quant à la soupe, elle nous était versée dans les
quarts du « café » matinal. Nous étions littéralement affamés ;
nous avons tout absorbé dès notre retour dans la chambrée et ce n’est que par
la suite que nous avons appris que nous percevions en une fois la ration de
deux jours.
Ainsi, nous avions chaque matin un quart d’ersatz de café et un jour sur deux (pratiquement
les jours impairs) la ration quotidienne du S.T.O.
Entre deux distributions de nourriture, nous attendions, la faim au ventre. A
Woippy, je compris pleinement l’expression « Long comme un jour sans pain ».
Il nous arrivait quand même de devoir travailler. Deux ou trois fois par semaine –
jamais plus – nous allions à pied dans une petite usine voisine
[2] (il s'agit de l'usine Hobus Werke). Le chemin était parcouru en colonnes de
trois, sous garde armée ; la moindre tentative d’évasion au détour du
chemin aurait été sanctionnée d’un tir à balles réelles ; nous en avions
conscience et nous nous gardions du moindre mouvement que les SS auraient pu
interpréter comme un commencement d’évasion. Sur place, nous étions chargés
d’un travail de terrassement. Dans la réalité, ce n’était pas terrible ;
après avoir mis quelques pelletées de terre dans un wagonnet, nous poussions
celui-ci sur les rails étroits deux cents ou trois cents mètres avant de le
vider. Encore les SS jacassaient-ils entre eux et se désintéressaient-ils de
nous pendant cette corvée. Nous remplissions les wagonnets au tiers de leur
capacité, de sorte que les allées et venues de wagonnets sur les rails se succédaient
à un rythme acceptable. J’étais très étonné que les SS n’aient jamais cherché à
contrôler notre volume de travail, et encore moins à augmenter notre
performance, mais il en était ainsi, et notre manège, qui sauvait les
apparences, se répétait à chaque corvée sur le site.
Nous passions donc la plupart de notre temps dans la chambrée et parfois toute la
journée, depuis le « café » du matin jusqu’à la revue du soir qui
avait lieu dans la cour aussi bien les jours impairs (avec distribution de la
nourriture) que les jours pairs (où l’on jeûnait), sauf quelques exceptions
comme, par exemple, le soir de notre arrivée. Ce rassemblement,, sans doute prévu dans un règlement, était néanmoins
inutile car on n’y distribuait rien, sinon des coups, et l’on n’y faisait même
pas l’appel. Pendant ces temps d’inactivité forcée, nous n’avions d’autre
solution que de parler, toujours à voix modérée par peur d’une intrusion des SS
– moins nous les voyions, moins mal nous nous portions. Nos conversations
vagabondaient sur tous les sujets, pour autant que l’interlocuteur acceptât le
sujet. Aucun d’entre nous ne pouvait avoir quelques informations sur les
opérations militaires postérieures à son entrée dans le camp ; c’était
comme si la guerre et la vie s’étaient arrêtées depuis notre arrivée ou comme
si le cours en avait été suspendu. […]
Mes interlocuteurs préférés étaient Marcel […] et l’Américain dont le nom
ressemblait à Schmidt, Schlick ou Schultz. Marcel,
dont je savais déjà qu’il n’avait pas quitté son dernier oflag récemment, me
donna davantage d’explications sur sa cavale permanente ; il subsistait de
mille façons, toujours à la recherche d’un moyen pour quitter
l’Allemagne : il avait été repris plusieurs fois et reconduit dans des
oflags dont il s’était de nouveau échappé. Il trouvait de l’aide partout chez
les Français, dans les stalags ou les camps de S.T.O. ;
il me parla de filières d’évasion et d’un prêtre, prisonnier de guerre à
Cologne, qui avait été décapité à la hache pour avoir été à la tête d’une telle
organisation : le supplicié était l’abbé Rondeau. Marcel, depuis plusieurs
années, n’avait qu’un objectif : l’évasion ; son esprit revenait
invariablement au but qu’il s’était fixé et sans doute plus souvent encore
qu’il ne s’en ouvrait à moi ; c’était le leit-motiv d’une saga personnelle. […]
J’avais trouvé sous une paillasse un éclat de bois d’une dizaine de centimètres ;
au long de ces interminables journées, j’affûtai cet éclat sur le montant d’un
lit pour le transformer en ersatz de couteau, qu’à l’arrivée d’un SS je
dissimulais prestement dans un angle de châlit et dont je me servais pour
étendre la margarine sur mon pain. Nous ne disposions en effet que du quart qui
servait aussi bien pour le café que pour la soupe et nous étions dépourvus de
couteaux et même de cuillères.
Encore une fois en aboyant, gesticulant et tapant, les SS introduisirent un nouveau venu.
Il avait l’air quelque peu hébété ; il avait la peau fanée, dont la teinte
était indéfinissable, plutôt grise avec un soupçon de jaune ; ses yeux
étaient bridés. Il était bien difficile de converser avec lui qui ne comprenait
pas trois mots d’allemand. Le seul mot que nous comprenions nous-mêmes était
« Da » quand il acquiesçait. Peu à peu, nous sommes arrivés à
considérer comme certain qu’il était soviétique, venant d’une république
musulmane d’Asie centrale. Qu’y faisait-il ? Il disait « ouatt » et mimait une cueillette ;
nous en avions déduit qu’il travaillait dans une culture de coton (ouate); nous
comprendrons aussi qu’il avait été émerveillé en découvrant Moscou et ce sera
tout en ce qui le concernait. J’aurais bien aimé connaître son histoire,
comment et pourquoi il avait échoué au camp de Woippy.
Son arrivée posa un problème : nous étions désormais onze et il n’y avait que dix
châlits pour dormir. De lui-même, le Soviétique trouva la solution en se
couchant sur deux paillasses superposées à même le sol ; ce n’était
peut-être pas la plus mauvaise place. La nuit, nous dormions tout habillés,
sans couverture. Nous devions être au pied des lits quand Savatski
ou un autre SS entrait dans la chambrée ; encore nous fallait-il
préalablement remettre en place les lits factices, ce que nous faisons le matin
au premier bruit venant du couloir. Dieu merci, ces brutes aimaient le vacarme
et les hurlements, de sorte qu’ils nous prévenaient eux-mêmes de leur arrivée.
Deux ou trois fois, nous fûmes astreints à des corvées plus lointaines que l’usine aux
wagonnets. Nous partions à six ou huit, assis dans la benne ou sur la
plate-forme d’un camion ; en face de nous, un SS, calé dans un coin,
gardait sa mitraillette sur les genoux ; une voiture précédait ou suivait
le camion, dans laquelle avaient pris place Savatski
et quelques autres SS. C’est ainsi que nous traversâmes les lignes Maginot et
Siegfried, puis Sarrebruck pour aller dans un château vider une pièce dans
laquelle étaient entassés livres, journaux, revues sur plus d’un mètre de
hauteur ; j’y découvris un recueil des reproductions – à cette époque, on
ne parlait guère de photocopies – des notes de l’Etat-major français de 1938 à
1940 ; il y avait des cachets « Secret », « Très secret » et même « Secret-secret »
(le pléonasme était peut-être ce qu’il y avait de mieux pour attirer l’attention).
Toujours était-il que les Allemands avaient su – et, dans ce château, j’en
avais la preuve – beaucoup des mouvements de nos troupes, que tel régiment de
tirailleurs sénégalais avait été envoyé à Djibouti, que tel site avait été
doté d’une batterie en France, etc. Je constatai ainsi que notre armée
avait été truffée d’espions ; la « cinquième colonne », dont on
nous avait rebattu les oreilles pendant la « drôle de guerre » avait
donc réellement existé. Cette découverte me consterna. J’aurais aimé emporter
ce recueil mais, dans les circonstances présentes, il ne pouvait pas en être
question. Je l’ai vraiment regretté.
Une autre fois, nous sommes passés par Metz afin de déménager un coffre-fort. […]
Traverser Metz, même sous la menace d’une mitrailleuse
tenue par un SS borné et dangereux, était un plaisir. Je regardais les
boutiques qui étaient bien françaises car leur aménagement était très différent
des boutiques qui existaient en Allemagne. Nous passions dans des avenues
bordées de marronniers en fleurs ; il n’y avait pas de marronniers à
Hambourg ni à Brême. Ce jour-là, les cloches des églises et de la cathédrale
Saint-Etienne sonnaient ; des premiers communiants,
portant un brassard au bras gauche, se dirigeaient vers une église ; la
silhouette des premières communiantes parlait à mon cœur, avec leur longue robe
blanche qui leur descendait aux pieds et le voile léger dont leur tête était
couverte ; comme elles étaient belles ! J’aurais voulu pouvoir les
embrasser. Ces enfants nous apportaient la preuve que nous étions en France,
malgré l’annexion. Un tel spectacle n’existait pas en Allemagne. Les premiers
communiants poursuivaient leur chemin et étaient tout à leur grand jour fait de
piété et de festivité ; ils ignoraient qu’ils m’avaient procuré un petit
moment d’émotion et de bonheur.
En rentrant de la corvée de déménagement du coffre-fort, à laquelle nous avions été
conduits un jour impair – donc sans nourriture depuis l’avant-veille – le désir
me prit de m’allonger dans la chambrée avant d’aller toucher la ration tant
attendue. J’oubliai que les lits supérieurs étaient factices et, stupidement,
je me couchai sur un lit du haut ; les quatre planches ne résistèrent pas
à mon poids et je chutai sur le lit du bas. […] Je dus soutenir mon bras droit
avec ma main gauche pour aller recevoir ma ration de deux jours. Il n’était pas
envisageable de demander une aide quelconque à nos anges gardiens qui,
d’ailleurs, ne remarquèrent pas mon attitude ce soir-là, ni les jours suivants.
Que se serait-il passé s’il y avait eu du sang sur ma chemise ? La douleur
resta vive plusieurs jours ; elle ne s’estompa que bien lentement.
Au camp, certains jours étaient encore plus pénibles que d’autres parce que les SS
avaient décidé une nouvelle vexation. Je ne sus pas pourquoi l’on nous
rassembla dans la cour à une heure inhabituelle ni pourquoi Savatski
procéda à une distribution de paires de claques. Il passa dans nos rangs et
frappa méthodiquement chacun de nous deux fois au visage. Des claques
attribuées de sa main énorme, faites pour faire mal. Quand il arriva à moi, je
retirai mes lunettes pour les protéger ; il eut une seconde d’étonnement,
puis il dut penser que je coopérais et m’administra
les deux claques auxquelles j’avais droit. Et il passa au suivant. Il ne
faiblissait pas quoiqu’il eût donné plus de cent paires de claques. Il n’était
pas douteux que, la séance terminée, il eut la main endolorie. Ce fut tout le
mal que nous avions pu lui faire.
Je ne savais pas pourquoi non plus, un autre jour l’on nous rassembla dans un angle
de la cour ; un officier SS, que nous n’avions jamais vu, présidait la
cérémonie. Il y avait un petit édicule de bois qui ressemblait à une guérite
étroite et dont la porte était cadenassée de l’extérieur. Sur un ordre de
l’adjudant, un SS déverrouilla la porte et fit sortir un être minable :
tout nu, barbu, maigre, maigre ; profondément troublés, effarés, nous
voyions ses os, les coudes étaient plus gros que les bras et les avant-bras,
les genoux plus gros que les jambes et les cuisses ; le bourreau le fit
pivoter sur lui-même et nous pouvions alors le voir de dos ; le pauvre
homme n’avait plus de fesses, sa colonne vertébrale apparaissait sous sa peau
décharnée. Qu’avait-il fait pour subir de telles tortures ? Depuis combien
de temps souffrait-il dans cette minuscule prison où nous comprenions qu’il ne
pouvait pas s’allonger, mais tout juste s’asseoir avec les genoux repliés
jusqu’au menton, restant ainsi avachi dans le froid, le noir et sur ses
excréments ? L’adjudant dit quelque chose et rit ;
les SS se mirent tous à rire. Le malheureux eut un rictus, comme s’il avait
voulu amadouer ses tortionnaires avec un sourire. Ce spectacle révoltant
ajoutait à la haine que nous éprouvions pour nos SS. Nous avons supposé que les
SS avaient monté cette mise en scène pour nous montrer le traitement inhumain
qui pourrait être le nôtre si notre conduite leur déplaisait. Mais avaient-ils
besoin d’un motif ? Ils se délectaient de la souffrance qu’ils avaient
licence d’infliger. Le plus triste était que nous ne pouvions rien faire pour
le supplicié, même pas lui donner une bouchée de notre pain, même pas lui
manifester notre pitié par un geste, même pas lui adresser une parole d’amitié.
Nous avions appris que « nos » affreux SS (non gradés) venaient de villages
russes lointains où ils travaillaient sans doute en kolkhozes. A l’arrivée des
divisions allemandes, reconnus comme faisant partie des minorités allemandes,
ils s’étaient engagés dans les SS, avaient été habillés et équipés mieux qu’ils
n’avaient jamais rêvé l’être. Les armes qu’on leur avait remises étaient leur
principale fierté ; à toute occasion, ils admiraient leur fusil et leur
revolver. De temps en temps, ils organisaient un concours de tir et visaient
des boîtes de conserves vides qu’ils posaient sur un talus ; ils n’étaient
pas très adroits et ne touchaient pas leurs cibles à chaque fois. Nous
redoutions d’avoir à passer derrière le talus dans ces moments-là. L’un des SS,
fier de montrer son revolver au contremaître de l’usine où nous véhiculions les
wagonnets, lui en expliqua le maniement et appuya malencontreusement sur la
gâchette quand il tenait l’arme en direction de son interlocuteur. Celui-ci
s’effondra devant nos yeux, peut-être mort. C’était vraisemblablement un
Messin, un Français par conséquent. Nous n’avons pas eu connaissance que le
meurtrier ait été seulement blâmé.
Au régime d’un repas tous les deux jours, nous nous étions mis à manger les pissenlits
que nous trouvions en manipulant les wagonnets ; bien que nous les ayons
secoués et frottés, les feuilles étaient un peu terreuses car nous n’avions pas
d’eau pour laver cette salade qu’il fallait d’ailleurs consommer en cachette.
Nous les mâchions lentement, longtemps, pour tromper notre faim. Dans ce but,
j’ai vu certains internés mâchouiller du papier d’emballage ramassé le long du chemin.
Nous ne savions pas comment notre détention se terminerait. Certains parlaient d’un
camp à Struthof, plus humain, où les prisonniers recevaient – disaient-ils –
une ration de nourriture chaque jour ; ceux-là auraient souhaité y être
mutés. N’ayant pas seulement entendu le nom de Struthof auparavant, j’écoutais
sans rien dire ceux qui paraissaient savoir ; je me méfiais cependant de
leurs renseignements, ne comprenant pas comment ils avaient pu les obtenir
puisque nous ne pouvions parler à personne de l’extérieur. De toute façon, il
ne nous appartenait pas d’exprimer quelque désir. C’est après la guerre que
j’apprendrai que le camp de Struthof était un camp d’extermination, le seul que
les nazis avaient installé sur le territoire français. Quelle erreur dans les
bobards qui circulaient au camp de Woippy !
Il était peut-être midi quand un SS me fit sortir de la chambrée, seul. Je fus pris
d’une terreur panique que je m’efforçai de ne pas montrer. Il me conduisit au
bureau du camp où je retrouvai l’employé pâle au pauvre costume gris ; je
compris à ce moment-là seulement qu’il était interné comme moi et affecté au
bureau.
Il m’apprit que j’allais être libéré.
Je n’en croyais pas mes oreilles. L’homme du bureau posa sur le comptoir tout ce que je
lui avais remis à l’entrée et me demanda de vérifier s’il ne manquait rien. Nos
regards se croisèrent quand je m’aperçus qu’il manquait quelques cigarettes
dans mon paquet entamé mais nous n’avons sourcillé n i l’un ni l’autre devant
le SS resté là, et muet à présent. Je signai un registre et repris mes affaires.
Je n’ai pas su pourquoi mon internement prit fin et je jugeai plus prudent de ne pas poser
de questions. Je n’avais pas serré une seule main en quittant la
chambrée ; qu’allaient devenir mes compagnons de misère ? Cela non plus,
je ne pouvais pas le savoir. Adieu donc Woippy !
Libéré du camp de Woippy à la mi-mai, René Ratouis est
conduit dans un camp de transit à Metz, où il reste trois jours avant de
repartir pour Hambourg, aux usines Blohm et Voss.
Le lundi 15 novembre 2004, le maire de Metz, Jean-Marie Rausch, le député-maire de Woippy, François Grosdidier, et le président de la S.H.W. dévoilaient une plaque à l’emplacement du camp de répression nazi qui, entre l’automne 1943 et le 31 août 1944, vit passer 4336 détenus. Soixante ans après la libération de ce camp, reconnu en 1947 comme lieu de déportation, justice était enfin rendue à ces hommes, Lorrains pour beaucoup, qui payèrent par les sévices et les humiliations, voire par la mort – sur place ou en déportation en Allemagne – leur attachement à la liberté et leur rejet de la tyrannie. Après celui de René RATOUIS, voici les témoignages de trois anciens déportés : Christian BERKEL, de Metz Devant-les-Ponts, Antoine GRIS, de Moulins-lès-Metz, et Robert OBRECHT, de Freyming-Merlebach.
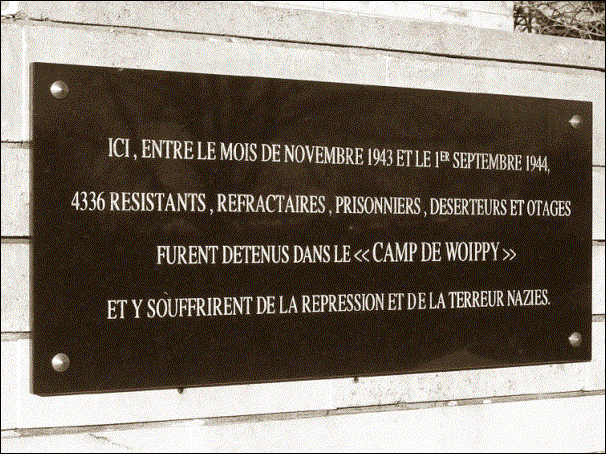
Plaque commémorative apposée à l’emplacement du camp de Woippy
au mois de novembre 2004
Christian BERCKEL : de Rotterdam à Woippy
Christian Berkel est né à
Rotterdam le 7 septembre 1920. Il n’a pas encore 20 ans lorsque la Wehrmacht
fait, en mai 1940, la conquête des Pays-Bas. Peintre de métier, socialiste et
syndicaliste comme ses parents, il aime retrouver ses amis dans un foyer de jeune travailleurs.
Au début de 1942, alors qu’ils sont en
train de jouer aux cartes, la Gestapo, accompagnée de militaires allemands,
fait une descente dans leur local, et arrête les jeunes gens, considérés comme
des « terroristes ». Christian Berkel est
interrogé pendant toute la nuit sur ses soi-disant activités subversives ;
licencié sous le prétexte que l’on n’a pas besoin de peintres, il est envoyé à
Lorient pour y travailler sur le chantier de la base de sous-marins. Le voyage
dure deux jours et deux nuits (6-7 janvier 1942). Logés dans des baraquements
en bois, les hommes travaillent douze heures par jour à préparer et à couler du
béton pour les murs et l’énorme toiture du bloc K III, en construction depuis
octobre 1941.
Au début du mois de janvier 1943, le chantier est bombardé par les Anglais, et
Christian Berkel, comme ses camarades, doit se mettre à l’abri dans un bunker car
les baraquements n’offrent aucune protection. Emmenés dans un camp, ils reviennent
à Lorient quelques jours plus tard, et parviennent, à l’occasion d’une nouvelle
alerte, à s’évader.
Avec un camarade, il réussit à escalader un wagon, et
c’est à plat ventre sur celui-ci qu’il prend la direction de Paris. Mais, au
Mans, ils sont pris et remis à la police française et interrogés. Finalement
relâchés, ils poursuivent leur route à pied, et par chance trouvent refuge dans
une ferme de la région parisienne tenue par… un Hollandais ! Transportés à
Paris, toujours sans papiers, ils parviennent à prendre le train pour
Bruxelles. L’objectif de Christian Berkel est de
rentrer en Hollande en passant par Anvers. Un projet qui manque de s’écrouler
en gare de Bruxelles, lorsque les Allemands procèdent à un contrôle
d’identité : affalé sur un banc, il fait semblant d’être profondément
endormi, et, bien que violemment secoué, n’ouvre pas les yeux, tout heureux
d’entendre dire : « Laisse tomber, il est soûl ! » et de
voir s’éloigner ceux qui n’auraient pas manqué de mettre fin à sa cavale.
Il parvient finalement à Anvers. La frontière n’est
plus très loin, mais elle est sévèrement contrôlée. Grâce à l’aide d’ouvriers
des chemins de fer, qui le guident jusqu’à un chemin non surveillé, Christian
Berkel parvient à reprendre un train qui, enfin, lui permet
d’atteindre Rotterdam et de retrouver sa famille.
Mais, pour lui, le pire reste à venir. Le 31 mars
1943, les Anglais bombardent le port et la zone industrielle de Rotterdam, et
le quartier où il réside est détruit. Le 16 juin, il est arrêté par la Gestapo,
et mis dans un train à destination du camp de Dachau. Mais Christian Berkel est
décidé à tout faire pour quitter ce train vers
la mort et s’évader : le convoi s’étant arrêté au sommet d’une butte, au
moment où il redémarre il réussit à soulever le crochet de la porte du wagon et
saute dans le vide : malgré les tirs des gardiens, il sort indemne de sa
courageuse et folle évasion. Parvenu à Cologne, il monte dans un train en
partance pour Metz.
Mais, sans papiers, comment échapper aux contrôles
d’identité ? Par un simple stratagème : il se réfugie dans les
toilettes, que bloquent des complices assis sur les bagages entassés devant la
porte. C’est ainsi qu’il débarque à Metz au début du mois de juin 1943… cette
même gare où le 18 juillet mourra, de suites des tortures infligées par Klaus
Barbie, Jean Moulin !
Ayant obtenu des papiers, Christian Berkel trouve un emploi dans la
reconstruction. Le 11 octobre, alors que son équipe travaille rue du Grand-Cerf
à démonter un grenier, l’un de ses collègues
trouve un drapeau français, qu’il fixe à une fenêtre. Un attroupement se forme
dans la rue, les SS arrivent, arrachent le drapeau et tentent d’arrêter les
« terroristes » qui parviennent à s’échapper. Pas pour
longtemps : la Gestapo arrête trois des fauteurs de troubles et, un peu
plus tard, Christian Berkel.
C’est avec le matricule 663 que celui-ci est interné dans le camp de Woippy
le 12 octobre 1943, comme détenu politique. Il va y rester trois semaines.
Il se souvient encore des sévices que fit subir à nombre de prisonniers Bachmann,
le bras droit de Kirchdorfer. Des coups de crosse assénés par les gardiens
SS, et qu’il reçut lui aussi. De l’obligation, chaque fois qu’il fallait se
déplacer, de courir, même avec la gamelle pleine de soupe. Etant prisonnier
politique, il n’était pas soumis au travail obligatoire à l’usine voisine Hobus Werke. Un
jour, lui et ses camarades sont transférés à Metz pour y être interrogés par la
Gestapo à propos du « torchon » - le drapeau français. Attaché par
les mains au radiateur, traité de communiste parce que sans religion, il est
frappé, mais il a « la chance », comme on lui dit, de ne pas être de
nationalité française, sinon on lui promettait le peloton d’exécution !
L’interrogatoire terminé, Christian Berkel est ramené
au camp de Woippy. Il en est libéré le 3 novembre, son ancien contremaître
s’étant porté garant pour lui.
Le 6 juin 1944, Christian Berkel se marie avec une jeune Messine… peut-être son
meilleur cadeau de mariage aura-t-il été d’apprendre que, le même jour, les
Alliés débarquaient en Normandie ! A l’approche des Américains, les
Allemands cherchant des hommes pour défendre Metz, il est emmené à la caserne
Barbot, et réquisitionné pour creuser des tranchées anti-chars entre Woippy et Maizières.
Menacé d’être enrôlé dans l’armée allemande, il
doit à un médecin hollandais d’en être exempté. Il se réfugie avec sa femme à
Charleville-sous-Bois, libéré par les Américains le 19 novembre.
Antoine GRIS, matricule 4208…
Antoine Gris est né à Feltre, en Italie, en 1922. Arrivé en France avec sa famille l’année suivante, il passe son enfance à Nancy, où il fait toute sa scolarité. En 1943, pour échapper au STO, il part travailler dans la région messine, où, avec quelques camarades, il est embauché par la société Johann Becker de Dillingen (Sarre), qui avait pris le marché de la réfection des toitures des fermes de Rezonville et de Vionville, abandonnées par les expulsés de 1940. Au début du mois d’août 1944, sachant que la libération est proche, il décide de rentrer à Nancy, avec un certain nombre de lettres des habitants de ces villages qu’il leur promet de poster en France. Il arrive au poste frontière de Novéant…
« Craignant une fouille sévère à la frontière de Novéant-sur-Moselle, je roule les lettres des
Lorrains, et les enfile dans le tube de selle, et dans le guidon, ceci pour ne
pas garder les lettres sur moi. Malheureusement, l’un des bouchons obturant le
guidon est tombé, et par le plus grand des hasards un douanier aperçoit quelque
chose de blanc dans le guidon. Il tire, c’est une lettre, les autres sont
évidemment découvertes, on cherche le propriétaire du vélo, on le trouve.
Alors que j’espérais en avoir terminé avec les Allemands, voilà que je
me retrouve à nouveau arrêté, et aujourd’hui ce n’est pas la gendarmerie, ni la
Wehrmacht, mais les SS qui en cette période névralgique gardent la frontière.
On me conduit, non pas à la prison
centrale de Metz, mais dans un camp de regroupement pour la région de l’est,
pour les déportés en attente de départ pour les camps de l’intérieur de
l’Allemagne. Ce camp est installé à Woippy en bordure de la route de Thionville,
en face d’une usine qui s’appelle Hobus Werke,
qui travaille pour l’armement. Cette usine sera vendue en plusieurs lots après
la libération, partie à Scholtès (fabricant d’appareils ménagers), partie à Davum
(commerce de produits sidérurgiques), et partie à la société Pierre Dumas, dont l’ironie du
sort fera que j’en deviendrai vingt ans plus tard le président-directeur général.
Pour l’instant j’arrive dans ce camp
constitué d’une dizaine de baraques, dans le style de toutes celles des autres
camps de concentration. Nous sommes 600 environ, régulièrement un convoi se
forme, pour une expédition dans des wagons à bestiaux pour une destination
inconnue. Il règne dans ces baraques une saleté repoussante. On m’affecte
une paillasse, après m’avoir délesté de mes bagages, bijoux, montre, papiers
d’identité, etc. Les poux et les puces règnent en maîtres. Quand je m’allonge
sur ma paillasse, j’ai l’impression de me plonger dans une baignoire pleine de puces,
elles sont tellement nombreuses qu’on les sent vous sauter sur le corps.
Il y a dans ma baraque, sur une
paillasse voisine de la mienne, un pauvre homme qui doit être là depuis
quelques mois, qui doit avoir un sang à puces, car son corps n’est qu’une plaie
à force de se gratter et de se faire sucer le sang par les poux. Il n’y a aucune
possibilité de se laver correctement, car le matin après le réveil les 600 détenus
sont lâchés dans la cour et se précipitent sur les deux seuls robinets qui existent dans le camp.
Comme ailleurs, il est formellement interdit de marcher, il faut courir en
permanence, sur place s’il n’y a pas de possibilité d’avancer. Les SS, cravache
à la main, frappent sans discernement, c’est dire que, tant pis pour les robinets,
il faut avancer et se mettre à l’abri des coups. Le matin, rassemblement
à 7 heures dans la cour, par baraque. Le responsable fait l’appel. Les différents
commandos se constituent pour aller au travail. La plupart doivent travailler à
l’Hobus Werke. Je suis affecté à un commando qui part tous les matins dans un fort
des hauteurs de Metz, le fort de Saulny.
Un jour, je fais dans ce fort, en
cours de journée, une rencontre extraordinaire. J’aperçois, travaillant dans
une équipe de travailleurs « libres », mon copain d’enfance et de
toujours, Jean Gingembre. Il n’est pas question de pouvoir lui parler ni même
de l’approcher, la surveillance des SS est trop stricte. Par geste, je lui fais
comprendre qu’il me faut à manger et du tabac. Durant la journée,
je demande l’autorisation de me rendre aux W-C, et là dans un coin je trouve un
morceau de pain et une petite boite d’allumettes avec du tabac et une feuille.
Jean renouvellera ces dépôts aussi souvent que possible. Un jour son
équipe n’était plus sur le chantier, je ne reverrai Jean qu’après la fin de ce
cauchemar.
L’ensemble de notre équipe assiste
un soir, sur le chemin du retour vers Woippy, à l’assassinat d’un de nos
codétenus, un jeune Polonais qui a tenté une évasion et qui a été repris
quelques heures plus tard. Ce pauvre type a été passé à tabac d’une manière
sauvage à coups de crosse de mitraillette, et achevé dans le fossé de la route.
Les jours passent. Je fais la connaissance et sympathise avec deux officiers français,
prisonniers depuis 40, évadés de leur oflag, puis repris avant la frontière et arrivés
dans le camp à peu près au même moment que moi, et un jeune garçon de Pont-à-Mousson.
Nous formons une équipe, et partageons ce que nous pouvons.
Les déportés continuent à arriver,
et des convois partent maintenant pratiquement tous les jours à destination de
l’Allemagne. Nous prions Dieu de n’en pas faire partie. Le
25 août, nous apprenons par une rumeur qui se propage à la vitesse de l’éclair
que les Alliés sont entrés à Paris. C’est la joie et l’espoir dans les
baraques, joie qu’il n’est pas question d’extérioriser car les SS sont de plus
en plus nerveux. Quelques
jours plus tard, vers le 28 ou le 29, nous entendons des coups sourds. Il n’y a
pas de doute, c’est le bruit du canon. Donc les Alliés approchent, la
délivrance nous semble proche. Mais attention, il faut redoubler de prudence,
surtout ne pas se faire remarquer, pour ne pas laisser sa peau dans ce camp
alors que nous en sommes, tout au moins l’espérons-nous, dans les derniers
jours de nos malheurs.
Dans la nuit du jeudi 31 août, vers
1 ou 2 heures du matin, nous entendons des bruits divers inhabituels, puis des
cris à l’extérieur : « Sortez, sortez ! Ils sont
partis ! ». Ces appels se poursuivent. Les jeunes dans ma baraque
veulent immédiatement tout casser, portes et fenêtres. Les anciens les
calment : « Attention, méfiez-vous, c’est peut-être une ruse, ils
nous attendent peut-être dehors avec les mitraillettes ». Nous
nous rangeons à leur avis et attendons. Mais les
coups et les bruits se poursuivant, très vite nous sommes tous dehors. Il faut
nous rendre à l’évidence, les SS du camp se sont enfuis, emportant tout ce qui
pourrait être de valeur, et laissant le camp à l’abandon. C’est la liesse
générale, mais c’est aussi une pagaille terrible. Il faut imaginer 600
personnes courant dans tous les sens, certains essayant de retrouver leurs
papiers. Il fait nuit noire. Les bureaux du camp sont désertés. Tous les
papiers sont dispersés, il y en a 20 cm sur le sol des bureaux. Impossible d’y
retrouver quoi que ce soit.
Avec mes trois amis, nous nous
interrogeons. Effectivement, les Américains sont à quelques kilomètres de Metz,
la libération devrait donc intervenir dans la journée, ou au plus tard le
lendemain. Alors, quoi faire ? Il n’est pas possible de rester sur place.
J’envisage de retourner à Rezonville où j’ai des amis, mais c’est se diriger
vers la ligne de front, et risquer de se retrouver dans la bagarre.
Le garçon de Pont-à-Mousson qui est
avec nous propose alors d’aller à Metz, où il a des amis qui, dit-il, ne
refuseront pas de nous héberger un ou deux jours en attendant la libération.
Nous nous retrouvons aux premières lueurs de l’aube à
Metz, rue Saint-Marcel, dans un garage où des gens
très sympathiques acceptent de nous accueillir et de nous réconforter. Pour la
première fois depuis longtemps, nous pouvons nous laver et partiellement nous
épouiller.
La journée du vendredi 1er
septembre avance, toujours pas d’Américains. Nous sommes indécis sur l’attitude
à prendre, nous diriger vers Pont-à-Mousson et Nancy qui doit être libérée,
mais c’est risquer de tomber entre les mains de l’armée allemande qui résiste
encore. Nos hôtes, gentiment, nous conseillent de rester chez eux encore
quelques jours, la délivrance ne devant plus tarder maintenant.
Or, les chars américains ont fait
une avancée foudroyante depuis la libération de Paris le 25 août, une percée
tellement rapide que l’intendance n’a pas pu suivre le même rythme. En arrivant
sur les hauteurs dominant Metz, vers le 30-31 août, les chars ont manqué
d’essence, la logistique n’ayant pas suivi, le ravitaillement des troupes non
plus. Les Américains ont donc décidé de faire une pause, de camper sur leurs
positions sur les crêtes devant Metz, et d’attendre le regroupement des troupes
et l’intendance pour affronter le dernier round, c’est-à-dire l’entrée sur le
territoire allemand. Nous
sommes donc bloqués dans notre garage. Le dimanche passe, et ce n’est que le
lundi que la peur nous reprend. En effet, une division allemande revenue à Metz
après avoir fui réoccupe la ville et se met à rechercher les déportés sortis du
camp de Woippy. Nombreux sont ceux qui, errant sur les routes, seront repris et
expédiés immédiatement vers les camps de la mort. »
Les souvenirs de Robert OBRECHT
« Réfractaire à la Wehrmacht, une tentative pour passer en France
s’est soldée par un échec dans la gare de Novéant, véritable souricière. Après un interrogatoire
serré, j’ai été incarcéré au camp de Woippy, dans la première baraque près de
l’entrée. Notre chambrée comprenait une dizaine de personnes, surtout Lorrains, arrêtées pour
différents motifs. Un quinquagénaire diabétique y purgeait une relative courte
peine pour avoir écouté Radio Londres. Le feldwebel Bachmann, pas loin de la
soixantaine, était affecté tout particulièrement à faire régner la
« discipline » dans notre baraque. Savatski,
son suppléant, n’était pas en reste pour distribuer les coups. Ils étaient
entourés de jeunes recrues SS, aux ordres.
Notre pitance se prenait devant la
baraque, aller et retour au pas de course. Bachmann activait le mouvement en
vociférant, avec coups de pied à l’appui sans oublier son gros trousseau de
clés qu’il nous abattait sur la nuque. Nous perdions souvent une partie du
contenu de nos gamelles au retour. Des repas que je n’ai pu avaler les deux
premiers jours, avant que la faim ne m’y habitue.
Je faisais partie d’un commando qui
effectuait des travaux de terrassement au-dessus et autour de nouveaux abris,
destinés au personnel de l’usine Hobus Werke, de l’autre côté de la route de Thionville. Il
fallait manier en permanence pelle et pioche. Je garde tout particulièrement le
souvenir d’un jeune SS me surprenant à récupérer. Il me fit entrer dans l’abri,
à l’écart des regards indiscrets. Je dus exécuter des pompes, qu’il aurait
voulu prolonger jusqu’à épuisement. Je l’ai satisfait en m’écroulant avant que
mes forces me quittent.
Un jour, pour une raison tombée dans
l’oubli, tous les détenus se sont retrouvés ensemble dans le couloir assez
large qui courait le long des cellules. Notre punition consistait à nous mettre
à la queue leu leu en faisant des sauts de canard
aller-retour autour de plusieurs SS disposés tout le long, sous la conduite et
les vociférations de Bachmann. Accroupis, nous devions sauter en avant, les
mains derrière la nuque. Les coups de crosse de fusil pleuvaient sur ceux qui
n’avançaient pas correctement. A la fin de l’exercice, plusieurs d’entre nous
furent ramassés et portés dans leur cellule.
Faisant partie d’un groupe pour le déménagement du mobilier de Bachmann
dans une localité du côté d’Ars-sur-Moselle, nous avons eu droit à un casse-croûte
généreux de son épouse, avec sa bénédiction… Bizarre personnage !
J’ai également assisté à l’ « exhibition », sous la conduite du Feldwebel,
de ce malheureux supplicié à l’état squelettique décrit par René Ratouis. Plus tard, j’ai
pu constater que c’était monnaie courante et à plus grande échelle au Struthof.
En attendant, nous étions bien gardés la nuit par deux ou trois molosses lâchés
autour des baraques. Les piqûres des satanées puces nous rendaient ces nuits bien pénibles.
La Gestapo n’a, entre temps, rien trouvé
après ses investigations selon mes « aveux » extirpés lors de mon
arrestation. Le deuxième interrogatoire confirma le précédent, malgré une paire
de claques. L’avenir de plusieurs personnes, dont mes parents, a pu ainsi être
préservé. Le copain d’Emile Meyer (de Woippy), arrêté avec lui pour les mêmes
raisons, a avoué que son père lui avait procuré l’argent français trouvé sur
lui… Le fils est revenu des camps de la mort, mais pas le père. C’était le
dilemme des Malgré-Nous.
Quant à moi, après mon passage au Struthof, je fus envoyé dans une de
ses annexes à Léonberg, près de Stuttgart. J’y suis resté jusqu’au lundi
de Pâques 1945, avant de pénibles déplacements jusqu’au camp de Mühldorf,
à 70 km à l’est de Munich, où l’armée américaine nous a libérés le 2 mai 1945.
Après plusieurs semaines de convalescence à l’hôpital militaire de Hérisau, en Suisse,
j’ai pu retourner chez moi le 23 juin. »
Le témoignage de Gilbert Goedert
A l’âge de 16 ans, le jeune Gilbert Goedert, pour avoir refusé de
revêtir l’uniforme allemand, connaît les atrocités des camps de Woippy du 20
janvier au 3 mars 1944, avant d’être déporté au Struthof puis à Buchenwald.
Voici la copie de la lettre qu’il envoya en mars 1946 à la Maison du Prisonnier
et Déporté à Metz.
« Après avoir passé dans la prison à Amanvillers, j’ai
été emmené au camp de Woippy. Un chemin boueux nous y conduit. En y faisant mon
entrée, j’aperçus quelques baraquements. Au milieu se trouve une petite cour où
les prisonniers, environ 150 à 200 font le tour en sautant dans une épaisse
boue. C’est ce que l’on appelle faire le canard. Au centre, se trouve un homme,
grand, maigre, aux cheveux gris : c’est Bachmann. A coups de nerf de bœuf,
coups de pied et cravache, il frappe sur les détenus malades, blessés, vieillards.
Pour lui, cela n’a pas d’importance.
Après avoir été fouillé et avoir reçu une couverture, une
gamelle, et aussi déjà quelques gifles, je suis conduit dans la baraque,
chambre 15, se trouvant tout au fond. Bachmann marche en avant, tenant en main
un gros trousseau de clés. Il ouvre la porte de la chambre et me fait entrer.
Les prisonniers qui s’y trouvent ne bougent pas. Ils sont au garde à vous. Mais
hélas, un des malheureux a fait un petit mouvement, et Bachmann s’élance sur
lui, frappe de son trousseau de clés, ne prenant pas garde à la figure ou
autres parties du corps. La porte s’étant refermée, les camarades m’expliquent
les règles à suivre pour éviter les coups de cravache.
Voici la vie au camp.
Le matin, réveil à 6 heures. Les lampes des baraques
s’allument. Tour le monde se lève et se déshabille torse nu, car nous couchions
habillés par rapport au froid. Le bruit des clés approche, c’est Bachmann, et
vite l’on se prépare. A peine la clé dans la serrure, la porte s’ouvre et c’est
l’appel.
Bachmann inscrit, tout en se promenant dans la chambre, car
il cherche un but pour pouvoir frapper, le moindre mouvement suffit pour qu’il
agite son nerf de bœuf. Après l’appel, c’est la toilette qui est faite en
quelques minutes, car on ne veut pas être le dernier, peur de la cravache. Je
dirais aussi que tout déplacement doit se faire en courant. La toilette
terminée, c’est le lavage des chambres qui s’effectuera le plus vite possible.
Muni chacun d’un chiffon et bien souvent même de nos mouchoirs, nous ramassions
l’eau gisant dans la chambre. Le seau dont on se servait était celui où l’on
urinait, de sorte que celui qui avait la moindre égratignure avait au bout de
quelques jours une grave plaie. Ensuite c’est le contrôle fait par Bachmann.
Pour une simple tache dans le plancher, il prend le seau d’eau, le lance dans la chambre,
et tout le travail est à refaire.
La gamelle en main, on attend le coup de sifflet. Premier
coup, chambres 17, 15 et 13 qui se situent dans le fond, là où je me trouvais.
Il y a deux tournants à prendre, chose très difficile à faire en courant.
Alignés le long du mur, plus un bruit, et Bachmann vient
se placer près des marmites de café noir et des portions.
La distribution commence, une louche de café, 250 grammes
de pain, une mince tranche de saucisson et un tout petit bout de margarine que
nous tartinions avec notre doigt. Tout cela doit se prendre en quelques minutes
car Bachmann est toujours là. Bien souvent la portion de margarine ou saucisson
nous échappe et tombe, nous ne voulons pas la ramasser mais Bachmann nous
l’oblige et profite de cette occasion pour nous allonger son nerf de bœuf sur
le dos.
Après tout cela, c’est le départ au travail. Au coup de
sifflet tout le monde se précipite dans la cour et s’aligne en deux rangées,
les derniers ne trouvent presque plus de place, encore une occasion pour
Bachmann. Le silence règne et voici l’appel. Après cela les groupes de travail
sont partagés. Kommando Rheuter,
Bahnhof (gare) (où M. Pierre Kopp m’a fait beaucoup de bien) et d’autres
Kommandos encore. Les équipes formées sont comptées,
et c’est le départ au travail.
Là, Bachmann aura quelques heures de repos. À midi, retour des Kommandos,
distribution de soupe, se faisant toujours à coups de cravache. À 13 heures, départ
au travail ; 17 heures, retour au camp où nous attend une bien maigre
soupe. Cette scène se répète tous les jours sans grands changements.
Brutalité de Bachmann.
Un matin, je me déclare malade. En faisant son entrée dans la
chambre, Bachmann inscrit l’appel et demande où est le malade. Il s’approche de
la paillasse et me demande ce que j’ai. Je lui réponds : « J’ai mal à
la gorge ». Il me fait ouvrir la bouche et de sa grosse lampe de poche, il
éclaire. À son avis, je ne suis pas malade et il me fait lever. Avec son
trousseau de clés et sa grosse lampe, il me frappe dans la figure et sur la
tête. Avec grand peine, je suis debout, mais, coincé
entre les paillasses et le mur, je ne peux pas en sortir, alors Bachmann se
sert des pieds. Prenant donc mon courage à deux mains, je donne un coup pour en
sortir. La figure en sang, je suis allé travailler. En ce jour, je possède
encore des traces de cette brutalité.
Un jour, après avoir mangé la soupe de midi, Bachmann
appelle Bahnhof, c’est-à-dire Kommando-gare dont je faisais partie. Me trouvant
tout au fond avec d’autres copains, nous n’avions pas compris et nous étions
aux aguets. Tout à coup Bachmann arrive et m’appelle, ainsi que trois
autres : « N’avez-vous pas entendu ? », mais pas
d’explications à donner, Bachmann nous fait accroupir et nous fait sauter
jusque dans la cour. J’étais le dernier car devant moi un pauvre vieux avançait
à grand peine, de sorte que les coups de cravache
s’abattaient sur nous, ainsi que les coups de pied.
Je termine non petit rapport dans l’espoir que beaucoup de
mes camarades auront comme moi le courage d’avouer toutes les atrocités qu’ils
ont pu subir ou voir subir par Bachmann, et j’espère que ceux qui auront à
juger pareil criminel lui appliqueront une peine bien sévère, car trop souvent
on est trop indulgent pour de pareilles brutes.
Dans l’espoir d’une suite favorable à mon rapport, veuillez
agréer, Messiers, mes salutations très distinguées. Signé Goedert. »
Ce document a été présenté lors du procès de Fritz
Kirchdorfer, le 17 novembre 1948, au Tribunal militaire permanent de Metz.