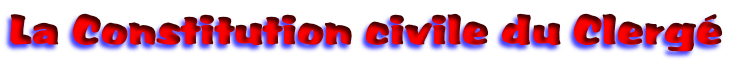Dans sa monumentale Histoire de l’Eglise du Christ, qui comprend quelque sept ouvrages en dix tomes, Daniel Rops traite de la Constitution civile du Clergé dans le troisième paragraphe du premier chapitre - « Une Epoque de l’histoire » - du premier tome - « En face de nouveaux destins » de l’ouvrage - « L’Eglise des Révolutions ». Le paragraphe s’intitule :
« La plus grande faute de cette assemblée »
Comme toutes les polices des titres de paragraphe, elle est en caractère gras. Daniel Rops l’encadre de guillemets pour le mettre en évidence et débute ainsi :
« Le 12 juillet 1790, l’Assemblée votait une loi portant réorganisation de l’Eglise de France. »
Le pouvoir législatif - il s’agit de l’Assemblée constituante - n’émet qu’un projet de loi qui prend le nom de décret. Si le pouvoir exécutif, qui dispose d’un droit de veto, promulgue le décret, ce dernier devient alors une loi d’Etat. La Constitution civile du Clergé s’intitule décret du 12 juillet 1790 ou loi du 24 août 1790.
Le décret du 12 juillet 1790 et son corollaire, le décret du 27 novembre 1790, déclenchent un conflit religieux, mais, comme tous les auteurs ultramontains, n’accusons pas l’Assemblée constituante ni le Comité ecclésiastique de tous les maux. Avant de les justifier, rappelons qu’au cours de la Révolution nous pouvons suivre plusieurs conflits :
Ø Conflits militaires ;
Ø Conflits politiques ;
Ø Conflits religieux, ces derniers aggravant les deux précédents.
Conflits militaires
Nous ne nous intéresserons qu’à la première annexion territoriale, celle d’Avignon et du Comtat Venaissin, conséquence logique de la condamnation de la Constitution civile du Clergé par le pape Pie Six :
« AVIGNON (annexion d'). Depuis le XIVe siècle possession des papes, enclave dans le royaume de France, Avignon et le comtat Venaissin étaient à la veille de la Révolution administrés par un vice-légat du pape. Il y avait une sourde hostilité entre l'administration pontificale et une bourgeoisie commerçante de fabricants en soieries qui revendiquaient une place plus importante dans l'administration de la ville et du Comtat. La Révolution française fut une incitation pour eux à s'emparer du pouvoir. En mars 1790, ils étaient les maîtres à Avignon et revendiquaient les mêmes droits que ceux qui avaient été acquis dans le royaume. Sur le refus du pape, ils votèrent, le 12 juin 1790, la réunion d'Avignon à la France. Dans les campagnes du Comtat, une partie des populations souhaitait maintenir des liens avec Rome. Une petite guerre civile s'engagea, mais, grâce au soutien des militants révolutionnaires de la Drôme et des Bouches- du-Rhône voisines, les partisans de la Révolution finirent par triompher. Après de longues discussions, la Constituante finit par décider l'annexion après un plébiscite où 102 000 des 150 000 votants optèrent pour la France. Annexés le 12 septembre 1791, le comtat Venaissin et Avignon furent le lieu d'une sanglante vengeance des révolutionnaires triomphants qui massacrèrent, dans la nuit du 16 au 17 octobre 1791, plus de 60 partisans du pape détenus dans la prison de la Glacière. Le pape Pie VI protesta en vain, le 3 mars 1792, déniant aux peuples le « droit de renverser les empires ». En été 1793, regrettant amèrement leur intégration à un État devenu terroriste, les Avignonnais rejoignirent la révolte fédéraliste inspirée par la Gironde. Vaincus, ils eurent droit à un tribunal révolutionnaire spécial qui envoya à la guillotine, de juin à août 1794, 332 « contre-révolutionnaires.» Dictionnaire de la Révolution française
Conflits politiques
Enumérons, par ordre alphabétique, les différents clubs ou groupes que nous rencontrons, au cours de la Révolution : Babouvistes, Breton (club), Clichy (le club de), Cordeliers, Dantonistes, Enragés, Feuillants, Girondins, Hébertistes, Indulgents, Jacobins. Dans un grand élan de fraternité, les membres de ces factions vont « s'entreguillotiner »
Conflits religieux
Culte de la Raison « Dans une intention de déchristianisation, un certain nombre de révolutionnaires favorisèrent le culte de la Raison. La Commune de Paris décida d'affecter l'ex-cathédrale Notre-Dame à ce nouveau culte. Une première fête eut lieu le 10 août 1793 sur la place de la Bastille où fut érigée une statue colossale de la déesse Raison. Hérault de Séchelles, président de la Convention, fut le héros de cette journée et adressa ses hommages à la nouvelle divinité. Le 20 brumaire an II (10 novembre 1793), une seconde fête eut lieu à Notre-Dame. On construisit dans le chœur une montagne en bois peint sur laquelle se dressait le temple de la Raison éclairé par le flambeau de la Liberté. Les membres de la Commune, escortés d'un chœur de jeunes filles, s'installèrent au pied de la montagne. La déesse Raison, une actrice, Mlle Aubry, sortit du temple et vint recevoir les hommages de l'assistance tandis que les chœurs entonnaient l'Hymne à la Liberté, dont les paroles étaient de Marie Joseph Chénier, la musique de Gossec. Cette campagne de déchristianisation déplut d'autant plus à Robespierre, qui croyait en l'Etre suprême, qu'elle émanait de ses adversaires politiques hébertistes et dantonistes. » Dictionnaire de la Révolution française
Culte de l’Etre suprême « Ce culte déiste et patriotique fut inauguré à Paris, le 8 juin 1794. Issu de l'esprit des philosophes du siècle des lumières, l'Être suprême était une divinité impersonnelle qui aurait créé l'univers. Mentionné au détour des textes au début de la Révolution, cet Être suprême prit une importance croissante au fur et à mesure de l'accroissement de la tension entre la Révolution et le catholicisme. Dès 1793 se développa le culte de la Raison. Transformée en temple de la Raison, la cathédrale Notre-Dame fut le siège du culte de la Raison à partir du 10 novembre 1793. Mais Robespierre, hostile à la déchristianisation extrême, lui opposa le culte de l'Être suprême, allié à la célébration du patriotisme, du civisme et à la fête du repos du décadi. Le 7 mai 1794, il présenta un rapport au nom du Comité de salut public en faveur de ce nouveau culte qui devait offrir aux Français une religion d'État destinée à consolider la Révolution et à représenter une substitution au catholicisme. C'est David qui fut le grand organisateur du culte de l'Être suprême. Robespierre marchait en tête de la procession, suivi par les membres de la Convention, et tous se réunirent sur une montagne artificielle érigée au Champ-de-Mars, chantant des hymnes, prêtant des serments de haine éternelle à la tyrannie des rois, avec en final le cri de « Vive la République ». De nombreux conventionnels ne cachèrent pas leur hostilité à cette pitrerie et certains allèrent jusqu'à traiter Robespierre de tyran. Cinquante jours plus tard, il tombait et son culte de l'Être suprême avec lui. »
Culte décadaire « Le culte décadaire fut institué avec le calendrier républicain, qui faisait disparaître toute référence au christianisme. Les fêtes chrétiennes furent alors remplacées par des fêtes révolutionnaires, placées le décadi, dixième jour, seul chômé. Le 23fructidor an VI (9 septembre 1798), une loi régla le culte révolutionnaire du décadi. On devait lire en grande pompe, en présence des enfants des écoles, les textes de loi dernièrement votés. Les mariages étaient célébrés exclusivement ce jour-là. Un Bulletin décadaire devait diffuser cette nouvelle foi. Il n’eut pas davantage de succès que la religion qu’il devait propager. Celle-ci disparut le 26 juillet 1800. » Dictionnaire de la Révolution française
Théophilanthropes « Après le culte de la Raison et celui de l'Etre suprême, la théophilanthropie est un nouvel essai pour trouver une religion de substitution au christianisme. L'origine en est le Manuel des théanthrophiles, bientôt changé en « théophilanthropes », publié en septembre 1796 par un libraire franc-maçon, Chemin-Dupontès. Le culte commence en janvier 1797 dans l'ex-chapelle Sainte-Catherine, dans l'école pour aveugles que tient Valentin Haüy, un des premiers adeptes de la secte. Après le 18 fructidor, le Directoire encourage le mouvement et lui concède quatre églises à Paris, dont Saint-Roch et Saint-Sulpice, et Notre-Dame en avril 1798. A l'automne 1798, la nouvelle religion a quinze églises rien que dans la capitale, et des succursales à Dijon, Mâcon, Auxerre, Poitiers, Bordeaux. Parmi ses adeptes figurent Bernardin de Saint-Pierre, Daunou, Dupont de Nemours, Sébastien Mercier, J.-B. Regnault, M.-J. Chénier, Tom Paine. Le journal La Décade le soutient et des connexions sont établies avec le culte décadaire. Une telle expansion n'est possible que grâce à l'appui du directeur La Révellière-Lépeaux et du ministre de l'Intérieur Sotin de la Coindière. Le gouvernement subventionne le journal de la secte, L'Ami des théophilanthropes. Après le coup d'État du 22 floréal, en mai 1798, le gouvernement retire progressivement son appui à un mouvement qu'il juge trop proche des Jacobins. Seul La Révellière-Lépeaux continue à le soutenir. Il dispose encore de dix-huit églises en 1799. Bonaparte l'interdit le 4 octobre 1801. La religion des théophilanthropes emprunte largement son rituel austère aux calvinistes lectures à haute voix de textes édifiants, hymnes chantées en chœur, sermons dont certains sont dus à Daunou, services funèbres, notamment pour Hoche... Les théophilanthropes croient en Dieu et à l'immortalité de l'âme, mais non au péché originel. L'importance qu'on leur a parfois attribuée semble très surfaite. Dictionnaire de la Révolution française
La Rupture du Concordat de 1516
Intéressons-nous au sens du terme concordat :
« Le terme concordat - ainsi que des dénominations analogiques comme « convention », « accord », « traité », « modus vivendi » ou « entente » - désigne les accords diplomatiques signés entre le Saint-Siège et un Etat donné dans le but de régler des sujets d’intérêt religieux les concernant l’un et l’autre. Plus précisément, il s’agit de conventions grâce auxquelles les deux parties règlent bilatéralement la nature juridique, l’existence et les activités des institutions, des organismes et associations ecclésiastiques d’un Etat… » Dictionnaire historique de la papauté
Il nous faut reconnaître qu’en rompant unilatéralement ce traité, nous n’avions pas agi avec diplomatie. Comme l’Assemblée nationale ne peut en aucun cas s’immiscer dans les relations extérieures qui reviennent au pouvoir exécutif, la faute n’incombe nullement au pouvoir législatif, mais au pouvoir exécutif qui n’a pas fait son travail, dans ce domaine, et qui, n’étant pas d’accord avec le projet, aurait pu y mettre son veto que lui conférait la Constitution… Pourquoi l’Assemblée nationale devrait-elle porter le chapeau ? Que Daniel Rops et ses semblables revoient leur copie…
Et si Louis XVI, empreint d’un esprit machiavélique, - lui ou son entourage ; simple hypothèse de ma part - qui n’ignore pas que la majorité du peuple de France tient à sa religion, promulgue le décret de la Constitution civile du clergé, escompte ainsi le mécontentement de ses sujets, tout en retrouvant leur confiance, et discrédite, en sus, l’Assemblée nationale et les clubs…
Le Paroxysme du Gallicanisme
« Le gallicanisme n'est qu'un cas particulier d'un anti romanisme qui s'est souvent manifesté dans l'histoire chrétienne. Poussée à la limite, l'hostilité à Rome conduisit à la sécession protestante. Mais, cette révolte mise à part, la défiance à l'égard de la papauté, plus ou moins vive selon les temps et les lieux, ne cessa guère de se faire jour d'une façon ou de l'autre au cours des siècles, soit dans la chrétienté d'avant la Réforme, soit dans les pays restés catholiques après la rupture du XVIe siècle. S'agissant de la France, le gallicanisme fut un effort pour limiter l'ingérence du Saint-Siège dans la vie religieuse du pays en s'appuyant sur des droits anciennement acquis. Selon la qualité et les buts de ceux qui s'efforcèrent de le faire triompher, il fut tantôt ecclésiastique (surtout avant le concordat de 1516), tantôt régalien (au XVIe et au XVIIe siècle, puis à nouveau après le concordat de 1801), ou encore parlementaire (au XVIIIe siècle). Mais cette classification ne laisse pas d'être sommaire, car ces trois gallicanismes conjuguèrent parfois leurs efforts. Ils reflétèrent d'autre part une certaine mentalité nationale et comportèrent, en dessous des doctrines, une part non négligeable d'irrationnel. » Dictionnaire de l’Histoire du Christianisme
Déclaration du clergé de France ou Déclaration des quatre articles (19 mars 1682). Elle affirme que :
Ø le pape n'a qu'une autorité spirituelle, qu’il ne peut juger les rois dans le domaine temporel, ni les déposer, ni délier leurs sujets du devoir de fidélité ;
Ø le concile général est supérieur au pape ;
Ø les anciennes libertés de l'Église gallicane sont inviolables ;
Ø le pape n'est infaillible qu'avec le consentement de l'Église universelle.
Bossuet, cet ancien chanoine de Metz, y prit une part prépondérante. Ces articles furent condamnés par la constitution « Inter multiplices » d’Alexandre VIII, le 4 août 1690, le roi et ses évêques durent les rétracter en 1693, mais ils continuèrent d’être enseignés dans les facultés et séminaires français. Arrangement de l’article du Dictionnaire d’Histoire universelle de Michel Mourre.
Ces quatre articles de la charte du gallicanisme ne sont autres que les quatre articles du concile œcuménique de Constance (1414-1418), à l’élaboration desquels participèrent Pierre d’Ailly et Jean de Gerson, tous deux chanceliers de l’Université de Paris. Quant au Comité ecclésiastique de l’Assemblée constituante, il n’agit pas de manière paroxystique, mais gallicane comme ses prédécesseurs sous l’Ancien Régime.
La Pragmatique Sanction de Bourges, rendue par Charles VII, le 7 juillet 1438, s’inspire des canons du concile de Constance :
« Dénonçant dès le préambule les abus de la papauté et proclamant la supériorité du concile sur le pape, elle déclarait applicables en France les canons des conciles de Constance et de Bâle limitant les pouvoirs du pape. Elle proclamait la libre élection des évêques et des abbés par les chapitres et les monastères, supprimait les réserves, les grâces expectatives, les annates1), limitait les appels en cour de Rome, restreignait les effets de l'excommunication et de l'interdit. Accueillie favorablement par l'Église de France et par le parlement, la Pragmatique Sanction de Bourges ne fut jamais approuvée par Rome ; les ducs de Bourgogne et de Bretagne refusèrent également de l'admettre. Elle resta en vigueur jusqu'au concordat de 1516, niais avec des fluctuations, notamment sous le règne de Louis XI… » Dictionnaire d’Histoire universelle de Michel Mourre.
I) « Nom donné au Moyen Âge, à une taxe levée par la papauté à l’occasion d’une nouvelle collation d’un bénéfice mineur et dont le montant qui correspondait théoriquement aux revenus d’une année de ce bénéfice. » Dictionnaire de l’Histoire du Christianisme
Avant d’aborder la subordination de l’Église de France à l’État, intéressons-nous au concordat de Bologne.
Le Concordat de Bologne (18 août 1516)
Le 18 août 1516, lors du Ve concile du Latran (1512-1517), le pape Léon X, Giovanni de’ Medici, et le cardinal Antoine Duprat, grand chancelier de France, représentant le roi François Ier, signent le concordat qui marque la réconciliation de la papauté avec la couronne de France.
Cette affaire de « gros sous » annule la Pragmatique Sanction, supprime l’élection des évêques, des abbés et des prieurs par les chapitres. Le pape perçoit à nouveau ses annates, et le roi qui nomme aux évêchés ainsi qu’aux abbayes, devient ainsi le premier personnage de l’Église de France, détient le Trésor de l’Église de France et en dispose à sa guise. Le Parlement, l’Université de Paris, le chapitre de Notre-Dame et bien d’autres s’y opposent, mais en vain.
Et si la France ne bascule pas dans la Réforme, elle le doit non parce qu’elle est la Fille aînée de l’Eglise, mais … à cette affaire de « «gros sous ».
La Subordination de l’Église de France à l’État
Avant de démontrer que le concordat de Bologne ne se justifie pas canoniquement, rappelons que, seule, la séparation de l’Église et de l’État assure à celle-ci son entière indépendance. Le décret du 12 juillet 1790 n’assujettit nullement l’Église de France à l’État : en effet, ce sont les électeurs qui nomment aux évêchés, et ce, conformément aux articles 1er, 2 et 3 du Titre II (Nomination aux offices ecclésiastiques) :
« Art.1 er. A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir, la forme des élections.
Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité des suffrages
Art. 3. L’élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral, indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée départementale. » Archives parlementaires / BNF – Gallica
Le concordat de Bologne inféodait totalement l’Église de France au roi : en 1789, il n’y avait plus un seul roturier à la tête des 132 diocèses de France… Quant au concordat de 1801, n’assujettissait-il pas l’Église de France au premier consul puis à l’empereur ? Et pourquoi ne pas nous intéresser aux abus qu’entraînait l’investiture laïque dans le choix des prélats ? Je ne m’en tiendrais qu’à quelques abus que je découvre dans les affaires ecclésiastiques de notre diocèse :
« JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET, né à Dijon (alors diocèse de Langres) le 27 septembre 1627, reçut dès le 6 décembre 1635 - soit à 8 ans - la tonsure cléricale, qui le rendait apte à recevoir des bénéfices ecclésiastiques. Son père, Bénigne Bossuet, conseiller au Parlement de Metz depuis le 14 décembre 1638, avait un intime ami au chapitre de la cathédrale, Jean Royer, alors grand archidiacre, qui sut procurer un canonicat au jeune Jacques-Bénigne. La nomination ne se fit pas sans difficultés. Il parait intéressant de les exposer ici, d'après des données fournies par les délibérations capitulaires de l'époque. Un chanoine, du nom de Jean Berton, étant mort le 12 octobre 1640, sa prébende, située à Châtel-Saint-Germain, revenait à Eric de Saintignon, clerc du diocèse de Toul, en vertu de lettres de coadjutorerie avec future succession que lui avait données Jean Berton, lettres qui avaient été approuvées par la curie romaine (bulles du 24 novembre 1628) et par le roi (brevet du 13 mai 1629)), et régulièrement intimées au chapitre en juillet 1620. A la mort de Jean Berton, Eric de Saintignon demanda et obtint du comte de Lambert, gouverneur de la ville, un placet daté du 3 novembre 1640, ainsi que du Parlement un arrêt en date du 6 novembre 1640, lui permettant « de prendre possession du canonicat… vacant par le décès de maître Jean Berton ». Muni de ces pièces, Eric de Saintignon fut reçu chanoine par le chapitre le 14 novembre 1640. Mais Jean Royer revendiqua en sa qualité de tournaire à la mort de Jean Berton, le droit de disposer de sa prébende, et en pourvut, par acte du 20 novembre 1640, le jeune fils de son ami Bénigne Bossuet, alors âgé de 13 ans. Le différend fut porté devant le Parlement, alors siégeant à Toul. Par arrêt du 27 juin 1641, non seulement il débouta Eric de Saintignon et attribua le canonicat à Jacques-Bénigne Bossuet, mais déclara « mal rendu, abusif et nul » le statut capitulaire du 19 mai 1611 établissant les coadjutoreries avec future succession. Le chapitre, dans sa réunion du 2 juillet 1641, décida de se pourvoir au conseil privé du roi contre cet arrêt du Parlement, comme étant contraire « aux droits et privilèges du chapitre qui ont esté confirmés par le Roy…, par l'usage et commune observation, par la possession immémoriale depuis deux siècles…» » Registres capitulaires / Mgr Jean-Baptiste Pelt
Chanoine, à l’âge de 8 ans, et touchant une prébende à l’âge de 13 ans… Cet argent servait-il à l’A. M. D. G. (ad majorem Dei gloriam) ? à l’aumônerie ?
« HENRY DE BOURBON-VERNEUIL, devenu évêque de Metz par la mort du cardinal de Givry, ne reçut pas les ordres, ne vint jamais dans son diocèse, mais sut choisir de bons suffragants, tels que Nicolas Coeffeteau, de l'ordre des Dominicains (1617-1621), Martin Meurisse, de l'ordre des Franciscains (1629-1644), auteur de l'Histoire des évêques de Metz, publiée en 1634, et Pierre Bédacier, de l'ordre des Bénédictins (1645-1660), l'ami de Bossuet. En 1652, Henry de Bourbon résigna l'évêché de Metz en faveur du cardinal Jules Mazarin, à qui Rome refusa les institutions canoniques, ainsi qu'à François-Egon» de Furstemberg (1658) et au cardinal Guillaume-Egon» de Furstemberg (1663), successivement élus par le chapitre ou nommés par le roi. C'est donc à tort que des historiens tels que les Bénédictins, III, 291, 306, les font figurer dans la série des évêques de Metz.
L'étrange évêque, que fut Henry de Bourbon, se maria à l'âge de soixante ans, le 29 octobre 1668, avec une fille du chancelier Séguier, veuve du duc de Sully. Il mourut en 1682. Pendant que l'Église de Metz était ainsi sans pasteur, le princier de la cathédrale, Claude de Braillard de Coursan, se disant « vicaire général, seul, perpétuel et irrévocable », gouvernait le diocèse jusqu'à la nomination, régulière et canonique cette fois, de Mgr d'Aubusson de la Feuillade, au siège épiscopal de Metz, en 1669. » Registres capitulaires / Mgr Jean-Baptiste Pelt
Henry, duc de Verneuil, n’est autre que le fils d’Henriette de Balzac d’Entraygues, marquise de Verneuil, et du roi Henri, quatrième du nom… Pendant plus d’un demi-siècle, le bénéfice ecclésiastique - patrimoine attaché à une dignité ecclésiastique - de l’évêché de Metz servait au prince…
Prenons le cas du dernier prélat de l’Ancien Régime, ce paroissien de Moulins, Louis Joseph de Montmorency-Laval, premier baron chrétien. Ce cumulard hors pair résidait, en effet, au château de Frescaty, un domaine de 100 hectares, qui faisait et fait toujours partie du ban de notre commune. Son haut fait d’armes : l’anoblissement du chapitre cathédral de notre diocèse… Il cumulait les charges d’évêque de Metz, d’abbé de Saint-Arnould de Metz, d’abbé de Saint-Julien de Beauvais, d’abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, d’abbé du Mont Saint-Michel et de Grand Aumônier de France, depuis la révocation du cardinal de Rohan, archevêque de Strasbourg, consécutive à l’affaire du collier de la reine.
Il est temps de démontrer que le concordat de Bologne ne se justifie pas canoniquement et que l’investiture laïque dans le choix des prélats entraîna de tous temps, dans l’Église, des situations déplorables.
24 au 28 février 1075 Synode de la Réforme grégorienne
La Réforme grégorienne consacre la rupture entre le Sacerdoce et l’Empire, affranchit l’Eglise du césaropapisme impérial - nomination des évêques et des papes - et de la tyrannie de la noblesse romaine, entraîne la Querelle des Investitures, mais elle met fin à la période la plus scandaleuse de l’histoire de l’Eglise. Le cardinal Baronius qualifie cette période - une partie du 10e siècle - de « règne de la pornocratie ».
Au cours de ce siècle, 24 papes se succèdent sur le trône pontifical, soit un règne moyen de 4 années. Sept papes meurent assassinés, soit 29%. Trois femmes de la famille Théophylacte, Théodora l’Ancienne, Théodora la Jeune et Marosia, interviennent dans les élections pontificales et imposent sur le siège pontifical des êtres qui étaient leurs protégés et parfois leurs amants : Serge III, Jean XI, Jean XII, pape à 18 ans. Jean XI doit à sa mère, la sénatrice Marosia, le fait de monter sur le trône pontifical à l’adolescence. Albéric, son frère, l’emprisonne avec sa mère. Le pape et cette dernière mourront assassinés dans leur geôle. Jean XII, le comte Octavien, fils d’Albéric II de Spolète, accède à la dignité pontificale à l’âge de 18 ans. Il meurt, à l’âge de 27 ans, non assassiné comme Jean XI, mais au cours d’une séance de collaboration horizontale. Il y eut des dynasties pontificales : Colonna, les comtes de Tusculum, Crescentius, Théophylacte. Plus tard, Médicis, dynasties papale et pontificale.
La Réforme grégorienne, qui mit fin à tous ces scandales, est une réforme lorraine que nous devons aux moines de l’abbaye de Gorze, mais pêche par son côté théocratique.
De la Démocratie en Amérique (Alexis de Tocqueville)
Dans son introduction, Alexis de Tocqueville nous apprends que :
« Je me reporte pour un moment à ce qu'était la France il y a sept cents ans : je la trouve partagée entre un petit nombre de familles qui possèdent la terre et gouvernent les habitants; le droit de commander descend alors de générations en générations avec les héritages ; les hommes n'ont qu'un seul moyen d'agir les uns sur les autres, la force; on ne découvre qu'une seule origine de la puissance, la propriété foncière.
Mais voici le pouvoir politique du clergé qui vient à se fonder et bientôt à s'étendre. Le clergé ouvre ses rangs à tous, au pauvre et au riche, au roturier et au seigneur ; l'égalité commence à pénétrer par l'Église au sein du gouvernement, et celui qui eût végété comme serf dans un éternel esclavage, se place comme prêtre au milieu des nobles, et va souvent s'asseoir au-dessus des rois. »
Comme il n’y avait plus un seul roturier sur les sièges épiscopaux, en 1789, et que Louis Joseph de Montmorency Laval avait anobli le chapitre cathédral de Metz, l’égalité dans l’Eglise ainsi que la promotion du bas clergé n’étaient plus que lettre morte, soit un net recul par rapport au Moyen Âge.
Quant au décret du 12 juillet 1790, que souhaitait-il ? Que le peuple souverain, qui élisait ses dirigeants politiques, intervînt de même dans le choix de ses ministres du culte. Ce décret, tant vilipendé, est-il vraiment la plus grande faute de la Constituante ? A vous de juger, et, sans plus tarder, entrons en Révolution.